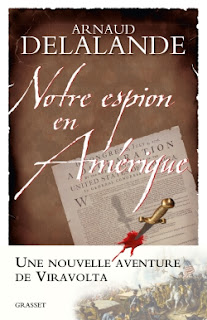N’ayant pas franchement le goût du martyre
« culturel », je n’ai jamais éprouvé de honte à
laisser un livre me tomber des mains quand sa lecture devient une
épreuve insupportable ; ni à quitter mon siège de spectateur
face à un film, une pièce de théâtre ou une représentation
musicale qui confine au calvaire.
Ma dernière retraite stratégique, en matière
cinématographique, je l’ai mené face à une armée hétéroclite
menée par quelques figures qui ont montré, en d’autres occasions,
qu’elles ont – ou avaient – du talent (comme Fany Ardant, avec
son charme à la fois proche et distant), épaulées par des gloires
de la guerre précédente (Michel Serrault, qui parodie Serrault),
trahies par des colonels qui ont acheté leur régiment sans avoir le
moindre talent guerrier (Arielle Dombasle, qui donne envie de
l’étrangler pour la faire taire), acoquinées avec des officiers
fantasques qui ne brillent qu’à une bataille sur cinq (Vincent
Perez, largement mieux inspiré dans Le Bossu de Philippe de
Broca) ou dont on se demande ce qu’ils viennent faire là (Josiane
Balasko, endossant un rôle tout en lourdeur et vulgarité), le tout
sous le bâton d’un maréchal dont on a du mal à citer une
bataille talentueuse (ne parlons même pas d’une bataille
raffinée !).
Oui, aimables lectrices et lecteurs, j’ai battu
en retraite – mais dans la dignité, bien sûr – face au Libertin
(2000) de Gabriel Aghion.
Pour le dire simplement, ce Libertin est au
genre libertin dix-huitiémiste ce que Blanche (2002) de
Bernie Bonvoisin est au genre de cape et d’épée. Un « truc »
indéfinissable, qui semble essayer de mélanger les références
irrévérencieuses aux canons du genre et la kolossale farce
franchouillarde. Indéfinissable, mais pas inqualifiable, au moins
sur l’échelle de mes goûts : le degré zéro.
Je comprends qu’Éric-Emmanuel Schmitt n’ait
pas été ravi de voir qu’Aghion a fait de sa pièce de théâtre,
Le libertin (1997), dont le film s’est inspiré (de loin, en
ce qui concerne la légèreté...).
Le libertin, c’est Denis Diderot, qui se réfugie
dans le domaine rural du baron et de la baronne d’Holbach, pour
écrire sans tarder l’article « Morale » de
l’Encyclopédie. Manque de chance pour lui, le château des
Holbach est fréquenté par une faune foutraque, un cardinal dévot,
une nymphomane, deux bougres, un eunuque, j’en passe et des moins
légers. Alors voilà Diderot en funambule, marchant sur le fil qui
sépare la philosophie (et sa morale collective) et le libertinage
(et ses plaisirs personnels).
Celles et ceux qui ont applaudi le Pédale
douce du même Gabriel Agion – celui qui avait adapté la
britannique et succulente et grinçante série Absolutely Fabulous
(1992-2012) pour en tirer le navrant film Absolument fabuleux
(2001) – applaudiront peut-être ce Libertin. Pour ma part,
j’ai plié bagage.
Je vais plutôt me revoir Ridicule (1996)
de Patrice Leconte ou Que la fête commence ! (1975) de
Bertrand Tavernier. La comédie grinçante dix-huitiémiste, il y en
a qui savent faire.
* * * * *
Défis. Ce billet répond au défi suivant :